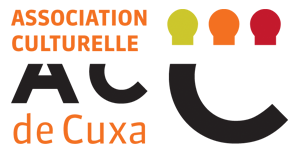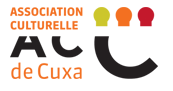Abbaye cisterciennes et des ordres réformés à l’époque romane
Lundi 7 juillet
L’unité architecturale et artistique dans les « ordres nouveaux » : déconstruction et résistance d’une idée reçue.
Alexis Grelois, Université de Rouen Normandie, UR 3831 GRHis
Dès l’an mil en Italie, un peu plus tardivement dans le reste de l’Europe, une floraison de nouvelles implantations religieuses vit le jour et se poursuivit jusqu’à l’avènement des ordres mendiants au début du XIIIe siècle : ermites, chanoines réguliers, hospitaliers, moines réformés, religieux militaires. En rupture avec les formes alors courantes du monachisme, ces nouveaux groupes mettaient l’accent sur la pauvreté vécue par le Christ et ses disciples, ce qu’ils exprimèrent notamment dans leurs constructions. Parmi ces nouveaux ordres, les cisterciens se détachèrent par le nombre exceptionnel de leurs abbayes, plus de 500 à la mort de Bernard de Clairvaux en 1153.
Dès le tournant des années 1930, Marcel Aubert et la Marquise de Maillé, puis le père trappiste Anselme Dimier dans les années 1960 ont donné naissance au concept d’art cistercien, auquel Georges Duby a conféré un éclat singulier, en France comme ailleurs. Le refus de l’ornementation, le dépouillement des églises et des cloîtres cisterciens, la fonctionnalité des enclos abbatiaux, l’uniformité stylistique des différents monastères cisterciens ont suscité l’admiration de Fernand Pouillon et Le Corbusier. Les célébrations des neuvièmes centenaires de la naissance de Bernard de Clairvaux (1990) puis de la fondation de Cîteaux (1998) qui s’accompagnèrent de la fondation de la Charte européenne des abbayes et sites cisterciens (1993) ont contribué puissamment à faire de la référence aux moines de Cîteaux un véritable label patrimonial. Même l’échec supposé de l’ordre — dont le succès, selon Robert Fossier n’aurait duré que le temps d’un éclair, avant sa chute brutale engendrée par l’accumulation excessive des richesses par ceux qui se voulaient les pauvres du Christ — avait les traits d’une morale universelle. Si l’on excepte les chartreuses (qui offrent très peu de témoignages architecturaux remontant aux deux premiers siècles de l’ordre), les tentatives similaires pour mettre en avant le patrimoine des nouveaux ordres nés au tournant du XIIe siècle, qu’il s’agisse de La Chaise-Dieu, de Grandmont ou de Fontevraud et de leurs dépendances n’ont pas connu le même succès.
Pour autant, le tournant du XXIe siècle a vu s’affirmer une critique de plus en plus radicale du concept d’art cistercien, qui a notamment remis en cause l’idée de plan-type et mis en exergue la diversité existant au sein d’un mouvement dont beaucoup de maisons furent affiliées et non créées par l’ordre. Conrad Rudolph a ainsi montré les divergences esthétiques opposant le véritable fondateur de l’ordre, l’abbé de Cîteaux Étienne Harding, à Bernard de Clairvaux. Si Mathias Untermann a reformulé le principe d’uniformité en « corporate architecture », d’autres chercheurs ont souligné l’ancrage des édifices cisterciens dans les architectures régionales. Plus récemment, notamment dans le domaine de la musicologie, Alicia Scarcez a cherché à montrer le poids des traditions clunisiennes dans la réforme liturgique promue par Bernard lui-même. La question de l’existence ou non d’une architecture et d’un art proprement cisterciens reste donc à trancher, en procédant notamment à une relecture critique des sources textuelles invoquées.
La nouveauté du colloque de Saint-Michel-de-Cuxa est de replacer les cisterciens dans un cadre plus large englobant d’autres ordres et congrégations nés à la même époque. Quelle fut l’ampleur de l’idéal d’uniformité, semble-t-il partagé par les grandmontains et les chartreux, mais non par les fontevristes ? L’une des particularités des ordres nouveaux mise en évidence par Jacques Dalarun est d’avoir cherché à intégrer de façon organique au sein de leurs communautés des groupes cantonnés à rester marginaux dans le monachisme traditionnel : femmes, laïcs (notamment paysans ou guerriers), malades ; il en résulta des structures mixtes avec des traductions architecturales plus ou moins bien connues (convers cisterciens ou grandmontains, sœurs et convers des chanoines prémontrés, etc.). Il peut donc être intéressant de croiser une analyse fonctionnelle avec une réflexion sur la pauvreté ostentatoire des ordres nouveaux. Enfin, il reste à analyser l’impact des nouvelles formes artistiques promues par des groupes sur l’ensemble des institutions religieuses.
Mardi 8 juillet
Un monument de la pensée cisterciennes : l’abbatiale romane de Fontenay
Philippe Plagnieux
L’abbatiale de Fontenay compte parmi les plus anciens monuments cisterciens conservés. Elle est, en outre, la seule à être parvenue jusqu’à nous parmi celles édifiées du vivant même de saint Bernard. Selon l’historiographie traditionnelle, l’abbatiale construite entre 1139 et 1147 découlerait de l’église romane de Clairvaux, élevée à partir de 1135 environ sous le gouvernement de saint Bernard. Fontenay refléterait alors directement la pensée du saint abbé. Le lien entre l’architecture et saint Bernard doit cependant être reconsidéré. Plus encore, il convient, d’une part, de revoir la chronologie de Fontenay la plus souvent admise et, d’autre part, d’en attribuer le projet à l’un des maîtres d’ouvrage les plus créatifs du XIIe siècle : Geoffroy de la Roche-Vanneau. Ce qui hisserait l’abbatiale au rang de prototype pour l’architecture romane cistercienne.
Abbayes cisterciennes d’Italie au XIIe siècle : nouvelles recherches
Silvia Beltramo, Politecnico di torino
Entre le milieu du XIIe et les premières décennies du XIIIe siècle, d’importantes architectures religieuses ont pris forme et ont été achevées dans le contexte des communautés monastiques du nord de l’Italie. Sur ces chantiers, de nouvelles solutions constructives ont été expérimentées, consolidant la pratique de la construction en brique dans la plaine du Pô. À la fin du XIIe siècle, les premières constructions cisterciennes étaient pour la plupart achevées en ce qui concerne l’édifice principal, tandis que les travaux se concentraient sur la finalisation des voûtes intérieures, des façades des églises et sur l’organisation des espaces monastiques. Les projets récurrents témoignent de l’adoption de modèles répandus au sein du réseau des édifices cisterciens, et les solutions constructives mises en œuvre, dans une succession de pratiques actualisées, ont également renforcé l’organisation du chantier par la standardisation de certains éléments constructifs, tels que la réalisation des systèmes de voûtes.
Les études approfondies menées ces dernières années sur les complexes de Staffarda, Lucedio, Casanova, Rivalta Scrivia, Morimondo, Chiaravalle della Colomba, ainsi que les recherches de collègues sur Chiaravalle milanaise et Cerreto, ont permis de définir un cadre composite de l’architecture cistercienne du nord de l’Italie. Les recherches sur les abbayes cisterciennes, en particulier dans ce contexte géographique, ont apporté une contribution significative au projet « Patrimonio culturale cistercense | Cistercian Cultural Heritage » (CCH), fournissant de nouvelles connaissances non seulement sur l’architecture et son langage, mais aussi sur les dynamiques spatiales du complexe monastique en relation avec les fonctions liturgiques et les besoins quotidiens des moines. À cet égard, les recherches menées sur les réfectoires monastiques et les espaces d’accueil pour les pèlerins et les malades sont particulièrement révélatrices.
Grâce à l’emploi d’outils analytiques novateurs, d’une approche multidisciplinaire et de relevés architecturaux ainsi que de diagnostics du patrimoine culturel, ont permis des avancées significatives dans la recherche, aboutissant à de nouvelles interprétations des données collectées. La communication mettra en lumière les études menées au fil des années sur les abbayes de Staffarda et de Morimondo en adoptant une approche comparative sur des sujets d’étude spécifiques. Parmi ceux-ci, les thèmes relatifs aux techniques de construction, aux matériaux historiques et aux géométries de conception permettent de dévoiler les processus des chantiers, la diffusion des modèles architecturaux, leur interprétation par les maîtres d’œuvre ainsi que l’intégration des pratiques constructives locales et celles introduites par des connexions et des influences extérieures.
Le silence monastique et ses déclinaisons architecturales chez les Cisterciens et les Chartreux
Vincent Debiais, EHESS
Le dépouillement et la retenue artistique, la sobriété des décors et la volonté de limiter les occasions de distraction visuelle ont été établis comme les « caractères » de l’art cistercien et cartusien, le reflet matériel des rigueurs de la discipline monastique, la traduction sensible des principes d’humilité et de discrétion, l’indice d’une certaine défiance face à des pratiques artistiques trop futiles pour être pures. Grâce à la lecture plus serrée des textes produits en contexte cistercien et chartreux et par une compréhension contextualisée de la notion d’ornatus, on revient très largement sur cette caractérisation et l’on reconnaît, dans les formes et les décors des ordres réformés, une esthétique singulière, intellectuellement très élaborée, qui accorde au visuel, et de façon contre-intuitive, une efficacité spirituelle au service de pratiques monastiques ancrées sur l’économie des moyens ostentatoires de la dévotion et sur le silence. Cette notion de silence, elle aussi caractéristique des spiritualités cistercienne et cartusienne, peut aujourd’hui fait l’objet d’un nouvel examen au prisme des textes produits au sein des ordres réformés afin de la comprendre sans anachronisme et de ne pas projeter sur le Moyen Âge un silence contemporain qui n’a pas grand-chose à voir avec ce que les religieux et les religieuses ont fait de leur voix. Le silence peut également être appréhendé dans les traces qu’il a laissées dans les monastères, dans la structure des bâtiments, dans leur décor architectural ou dans les images manuscrites. C’est à l’examen de ces « indices de silence » que se concentrera cette présentation convoquant des exemples produits entre la France et l’Espagne à l’époque romane.
Les granges cisterciennes. Entre pragmatisme économique et spiritualité du travail manuel
François Blary, ULB
Résumé à venir
Le mythe des moines bâtisseurs
Carles Sànchez Màrquez, UAB
Le célèbre commentaire d’Ordericus Vitalis sur la façon dont les moines cisterciens ont construit les monastères de leurs propres mains, ainsi que certains exemples iconographiques impliquant des moines bâtisseurs, ont donné naissance à une légende toujours vivante : la conviction que l’architecture cistercienne a été produite presque entièrement par des architectes et des artisans monastiques. La présente communication vise à répondre à certains aspects de cette discussion. Pour ce faire, les sources primaires de l’Ordre et différentes études de cas de constructeurs laïcs et de conversi dans les royaumes hispaniques ont été analysées.
L’abbaye Santa Maria di Casanova (Turin)
Ilaria Papa, Université des études de Padoue-ICEA
Ce travail présente les premiers résultats d’une étude récemment menée sur l’abbaye
cistercienne de Santa Maria di Casanova (Turin), dans le cadre du projet de recherche
international « Cistercian Cultural Heritage: Knowledge and Enhancement in a European
framework – CHH », sous la direction scientifique de Silvia Beltramo (Politecnico di Torino
– DIST).
Issue de la filiation de La Ferté et fondée en 1142 par des moines venus de Santa Maria
et Santa Croce di Tiglieto, Casanova constitue un cas particulièrement intéressant dans le
contexte du rayonnement cistercien vers les territoires transalpins à partir de 1120.
Cependant, cette abbaye a bénéficié, au fil du temps, d’une attention historiographique
moindre par rapport à d’autres fondations cisterciennes de la même région. L’étude des
phases médiévales a notamment été entravée par les profondes transformations architecturales qui, dès le début du XVIe siècle, ont affecté l’église, et par la perte des structures matérielles d’origine du monastère, entièrement reconstruit au début du XVIIIe siècle. Une attention plus soutenue a été portée aux chantiers d’époque moderne, à travers des recherches qui se sont toutefois principalement appuyées sur des corpus documentaires, sans proposer de lecture croisée avec l’analyse du bâti. Dans cette perspective, la recherche consacrée à l’église abbatiale de Santa Maria di Casanova a entrepris de formuler quelques réflexions sur les chantiers architecturaux (de la seconde moitié du XIIe siècle à nos jours), selon une approche méthodologique intégrée, croisant l’étude des sources matérielles et documentaires, avec une attention particulière portée au chantier médiéval. L’analyse du bâti, amorcée par un relevé architectural réalisé à l’aide de nouvelles technologies, a constitué la phase principale du travail. Outre le relevé photogrammétrique, une campagne de numérisation au scanner laser portable (GeoSlam) a permis de documenter les parties les moins accessibles de l’édifice, comme les combles, où subsistent des vestiges d’arceaux et des profils originels de couverture, éléments essentiels pour la compréhension du chantier médiéval. Un relevé critique détaillé des stratifications constructives a été mené sur tous les parements extérieurs visibles de l’église abbatiale, mais la lecture interprétative a également porté sur l’intérieur, afin de ne pas perdre de vue la cohérence de l’ensemble architectural. La reconstitution des phases de chronologie relative, puis de datation absolue obtenue par interpolation avec les données issues des sources documentaires, a constitué le moment de synthèse critique. La recherche a mis en lumière le rôle central de l’abbaye de Casanova dans le panorama des fondations cisterciennes du nord-ouest de l’Italie. L’archéologie du bâti a d’abord permis d’approfondir les connaissances sur la progression du chantier médiéval. L’étude du plan généré selon des géométries ad quadratum, des systèmes, techniques et matériaux constructifs employés pour les structures en brique, les voûtes ou encore les éléments fonctionnels (tels que la tourelle d’accès aux combles), ainsi que les langages architecturaux adoptés, ancrent la fondation turinoise dans la tradition constructive lombarde. Cependant, d’autres éléments remarquables suggèrent une migration de modèles transalpins, rapprochant certaines solutions des expériences bourguignonnes des premières fondations cisterciennes, tout en témoignant d’une capacité d’adaptation du ‘modèle idéal’ au contexte réel, aux contraintes du site et au savoir-faire local, probablement d’origine régionale. À l’échelle locale également, l’abbaye de Casanova se distingue comme un lieu d’expérimentation. Le chantier cistercien du milieu du XIIe siècle apparaît ainsi comme une forme de « ligne de partage », non seulement géographique, mais aussi entre langages architecturaux et manières de construire.
L’église Saint-Maxenceul de Cunault (Maine & Loire) et la construction en petit appareil dans le Saumurois médiéval
Mathis Prézelin, Université de Toulouse Jean-Jaurès, Université Bordeaux-Montaigne
Située sur la rive sud de la Loire, entre Angers et Saumur, l’église Saint-Maxenceul de Cunault est une petite église rurale en ruine, longtemps restée dans l’ombre de l’église prieurale Notre-Dame, chef-d’œuvre d’architecture romane angevine. L’étude du bâti de l’église Saint-Maxenceul réalisée dans le cadre du master Mondes médiévaux de l’université de Toulouse permet de mettre en lumière huit siècles d’histoire architecturale locale. Elle restitue les différentes phases de construction, de destruction et d’aménagements successifs de l’édifice, jusqu’à son abandon en 1754 à la suite d’une tempête qui fit s’effondrer le clocher sur le toit de la nef. L’intérêt principal de l’église réside dans la difficulté à attribuer une datation concrète à la maçonnerie en petit appareil de l’un de ses murs gouttereaux. En effet, l’étude de ce petit appareil particulier, constitué de moellons disposés à la verticale, en assises plus ou moins régulières, est l’occasion de replacer ce type de mise en œuvre au sein du contexte architectural angevin, afin de reconsidérer les datations attribuées aux édifices présentant les mêmes caractéristiques. À travers la constitution d’un petit corpus d’églises rurales du Saumurois, l’enjeu est d’élaborer une grille de caractérisation capable de produire une typologie pour alimenter la question de la datation en participant à identifier les éléments discriminants des élévations en petit appareil vertical. Un panel d’outils méthodologiques permet d’observer ces maçonneries avec précision. La méthode statistique est notamment employée pour caractériser la mise en œuvre, en interrogeant le rapport entre la longueur et la hauteur des moellons, la régularité de la taille de pierre ou la proportion des matériaux utilisés. La caractérisation des murs en petit appareil vertical du Saumurois aborde les thématiques de l’approvisionnement, de la restitution des échafaudages et de la pratique du remploi, pour replacer les édifices dans leurs contextes de construction. Cette recherche tente de contribuer à une meilleure compréhension des logiques constructives locales, en mobilisant une approche archéologique et statistique du bâti, et propose un cadre d’analyse applicable à un corpus d’élévations en petit appareil plus large.
Mercredi 9 juillet
Excursion : Abbaye de Fontfroide, ancienne abbaye de Sainte-Marie des Olieux (Domaine des Monges, Narbonne), Sylvain Demarthe.
Jeudi 10 juillet
Sénanque : étude archéologique, géologique et artistique d’un cloître cisterciens du XIIe siècle.
Heike Hansen (Aix-Marseille-Université, LA3M), Andreas Hartmann-Virnich (Aix-Marseille-Université, LA3M), Sylvain Demarthe (Université Paul-Valéry, Montpellier), Dylan Nouzeran (IRHiS – UMR 8529, Lille), François Fournier (Aix-Marseille Université, Cerege), Philippe Léonide (Aix-Marseille Université, Cerege)
Notre communication présente les premiers résultats du projet de recherche interuniversitaire et interdisciplinaire Sénanque. Etude archéologique, géologique et artistique d’un cloître cistercien en Provence romane (XIIe s.) conduit en plusieurs campagnes au cours de l’année 2025 avec le soutien financier des Universités d’Aix-Marseille et de Montpellier. Ce projet fait suite à un programme de relevé et d’étude archéologique conduit en 2021-2023 dans le cadre de travaux de restauration, qui avait mis en évidence le potentiel d’une analyse archéologique du bâti fondé sur le relevé pierre-à-pierre combinant les deux approches manuelle et numérique pour caractériser en détail l’organisation du chantier de l’église et de l’aile connexe des bâtiments claustraux et de préciser bien au-delà des acquis de la recherche antérieure la marche du chantier. La nouvelle étude du cloître fait converger le relevé et l’analyse archéologique du bâti et l’analyse géologique des matériaux employés pour la construction des murs et voûtes et pour les éléments du décor sculpté. Celui-ci fait l’objet d’une nouvelle approche approfondie visant à redéfinir sa place particulière dans l’art monumental du second âge roman provençal.
L’étude du bâti démontre que le chantier de l’abbaye de Sénanque, fondée en 1148 par l’abbaye ardéchoise de Mazan et construite entre la seconde moitié du XIIe et le début du XIIIe siècle, démontre l’incidence des contraintes topographiques sur la conduite du chantier qui dut, dans un premier temps, maîtriser le cours d’eau local en concevant un système de canalisations voûtées associées à un important ensemble de substructions voûtées dont la mise en œuvre entraîna en fin de compte une perturbation du projet initial. A hauteur du futur cloître, l’espacement des salles du niveau connexe de l’aile du dortoir, située dans le prolongement du transept de l’église orienté vers l’ouest et construite en même temps, dut être modifié pour s’accorder à une réduction de la longueur de la future galerie attenante du cloître. La construction de cette dernière et de la galerie longeant l’église suivit de près cette phase de la mise en œuvre, complétée ensuite par le voûtement qui fut placé à un niveau incompatible avec les ouvertures de la salle capitulaire déjà en place, salle dont les voûtes sur croisée d’ogives furent à leur tour insérées au détriment des baies déjà construites. Le contraste entre l’organisation cohérente et rationnelle de chaque phase du chantier et l’incongruité des repentirs survenus d’une phase à l’autre caractérisent les aléas de la réalisation d’un projet exécuté par une ou plusieurs équipes d’ouvriers habitués à prendre en compte les problèmes imprévus au fur et à mesure. Un des nombreux éléments inédits de cette chronologie complexe renouvelée est la mise en évidence d’un prolongement de la galerie longeant l’église qui formait probablement un ensemble avec le porche voûté détruit dont les vestiges subsistent dans la façade sud de la nef.
L’étude géologique confirme que le décor des deux galeries nord et est fut fait avec des variétés de pierre qui se distinguent de celles employées dans les deux autres galeries, différence qui s’accorde à la répartition des formes du décor sculpté. Quant à l’approche stylistique, le cas de Sénanque oblige d’interroger le concept d’« art cistercien » réputé pour la sobriété – voire l’absence – de son décor. Le « luxe de végétation » remarqué dès le milieu du XIXe siècle par l’inspecteur des Monuments historiques du Var, Louis Rostan invite encore une fois à la nuance et au renouvellement du regard sur la production artistique de l’ordre trop longtemps enclavée – malgré des tentatives de décloisonnements – dans sa longue historiographie.
La sculpture produite dans la sphère cistercienne au XIIe siècle n’a pas suscité l’intérêt des chercheurs. Celle-ci est souvent réduite à sa plus simple expression et est fondée sur la répétition d’un motif végétal de feuilles lisses, dont le traitement peut être très graphique. Dans le cloître de l’abbaye provençale de Sénanque, le décor réalisé au cours de la seconde moitié du xiie siècle développe toutefois une autre esthétique. Les chapiteaux, parfois très inspirés de modèles antiques – tout comme d’autres décors de frises, offrent une large gamme de végétaux plus souples et épanouis. Quelques chapiteaux annoncent par ailleurs un « premier gothique » dont les références paraissent plus septentrionales.
Les observations en cours permettent de replacer une grande partie de cette sculpture, ainsi que certains éléments de mise en œuvre des claires-voies du cloître, dans une production provençale plus large et aux références antiquisantes. Si cette remise en contexte n’est pas surprenante, elle permet de questionner à nouveau le concept dépassé d’« art cistercien ».
Héritage et opportunisme dans l’architecture primitive des chanoines réguliers de l’ancien archidiocèse de Reims
Sheila Bonde, Clark Maines
En 1967, J. C. Dickinson s’est demandé si les chanoines réguliers avaient développé une architecture aux caractéristiques propres à leur ordre, comme il le pensait chez les cisterciens et, plus tard, chez les franciscains. La réponse de Dickinson à sa propre question a été « presque certainement négative ». Dickinson et les chercheurs qui lui ont succédé ont recherché un « ensemble » cohérent de plans, de formes et d’éléments décoratifs. Dans cette communication, nous soulignons plutôt le phénomène de l’héritage.
Les nouvelles communautés augustiniennes, composées d’hommes et de femmes, souvent occupaient initialement d’anciennes églises collégiales ou paroissiales pendant la réforme religieuse qui a caractérisé la fin du XIe et le XIIe siècle. De ce fait, les réformateurs ont hérité d’une église et, souvent, des structures fonctionnelles qui l’accompagnaient, typiques des maisons religieuses. Les nouvelles communautés régulières ont également hérité un passé – terres, droits, possessions et mémoire historique – des communautés qu’elles ont remplacées.
Dans notre communication, nous examinons l’architecture des chanoines et chanoinesses réguliers—augustins indépendants, victorins, arrouaisiens et prémontrés—qui suivaient tous la règle de saint Augustin, quelles que soient les différences de coutumes de leurs ordres. Les chanoines et chanoinesses réguliers prospérèrent dans différentes régions la France au Moyen Âge, mais nous nous concentrerons sur l’ancien archidiocèse de Reims. Cette région vit l’établissement de 78 maisons de chanoines réguliers à la fin du XIe et au XIIe siècle, dont la maison mère de Prémontré. Dans 60 % de ces fondations anciennes, on trouve des témoignages d’héritage de structures antérieures.
L’héritage est donc une caractéristique essentielle et négligée de l’architecture des premiers chanoines réguliers. La reconnaissance de l’héritage comme composante essentielle façonne notre traitement de l’architecture canoniale au début de l’histoire de ces communautés. Des questions importantes se posent : de quoi les chanoines et chanoinesses réguliers ont-ils hérité ? Et (comment) ont-ils modifié les bâtiments dont ils ont hérité ?
Les premiers établissements carmélitains du pourtour méditerranéen (XIIe-XIVe siècle) : du Proche-Orient à la Provence
Margot Hoffelt
Longtemps écarté des recherches menées sur les ordres monastiques, l’ordre des Carmes a encore beaucoup à révéler sur le plan archéologique. Né du groupement de plusieurs religieux au sein des grottes du Mont Carmel à la fin du XIIe siècle, cet ordre singulier s’est établi sur l’île de Chypre et en Sicile avant de gagner les côtes provençales dans le second tiers du XIIIe siècle. Au travers du croisement des sources historiques et archéologiques, la présente communication se propose de retracer son itinéraire, en s’efforçant de caractériser l’évolution de ses dynamiques d’implantation et de son architecture qui, originellement semi-troglodytique, glisse vers des complexes inspirés des ordres monastiques occidentaux.
Les vitraux cisterciens: genèse, esthétique et cadre architectural
Sylvie Balcon-Berry, Sorbonne Université
En raison de nombreuses destructions, très peu de verrières cisterciennes nous sont parvenues. Pour la France, Helen Zakin, auteur d’une thèse sur la question, a recensé six sites qui présentent toujours des verrières in situ ou pour lesquels des verrières, à présent déposées, sont attestées. Il s’agit de La Bénisson-Dieu (Loire), Obazine (Corrèze), Noirlac (Cher), Bonlieu (Creuse), Pontigny (Yonne) et La Chalade (Meuse).
Le cas de Clairvaux (Aube) mérite également d’être cité, car si aucun élément de vitrerie médiévale n’est conservé, il est toutefois question dans des descriptions anciennes de verrières composées de verre blanc. Il en est de même pour Beaulieu (Tarn-et-Garonne) où Viollet-le-Duc a vu des vitraux en 1843 ; il publie d’ailleurs la gravure d’une des verrières aujourd’hui perdues.
Nous présenterons ces éléments, en lien avec leur contexte architectural, afin d’examiner la genèse, le développement et l’esthétisme du vitrail cistercien.
Un manuscrit enluminé de la Cité de Dieu de l’abbaye cistercienne de Berdoues (Gers)
Emilie Nadal, Institut de recherche et d’histoire des textes
Sur la centaine de manuscrits médiévaux provenant du couvent des Augustins de Toulouse et qui font l’objet d’un programme de recherche actuellement financé par Biblissima, se trouve une dizaine de manuscrits du XIIe siècle, peu ou pas étudiés, dont la provenance poste question. Parmi les exemplaires les plus luxueux, une Cité de Dieu de saint Augustin portant l’ex-libris de l’abbaye cistercienne de Berdoues (Toulouse, BM, ms. 164), dont le décor d’initiales ornées a été peu étudié. Rapproché en 1955 par Jean Porcher d’un autre manuscrits considéré comme cistercien, la Bible dite de Gimont (Auch, BM, ms. 1), ce bel ensemble d’initiales ornées d’animaux fantastiques et d’entrelacs, permet de reprendre le dossier de l’enluminure romane cistercienne dans le Sud-Ouest de la France.
Vendredi 11 juillet
Matin : visite du prieuré de Serrabona, Olivier Poisson
Le « nouveau » monachisme en Italie du Sud : manuscrits, fragments et documents à Montevergine (Campanie)
Veronica de Duonni, Université de Salerno
Fondée par Guillaume de Verceil (1085-1142) au cours du premier quart du XIIe siècle, l’abbaye de Montevergine est située sur le mont Parténio, dans l’actuelle province d’Avellino, au sud de l’Italie. Guillaume, pénitent et ermite, après avoir accompli un pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle, entreprit un nouveau voyage en direction de la Terre Sainte. Il s’établit finalement dans les régions apennines du sud de la péninsule italienne, où il donna naissance à plusieurs communautés monastiques d’importance. La forte personnalité de Guillaume attira rapidement de nombreux adeptes — hommes et femmes, disciples et clercs — animés du désir de se consacrer au service de Dieu. En l’espace de deux à trois décennies, la communauté fondée par l’ermite a adopté une organisation de type cassinienne-cavensienne, tout en affirmant une identité propre, en résonance avec les nouvelles formes de spiritualité que les historiens qualifient de «religiosité des œuvres». Cette présence se manifestait de plusieurs façons, dont l’engagement dans la vie religieuse des laïcs, à travers des actions comme l’accueil des pèlerins, le soin des malades et la pratique de l’oblation. Ce modèle monastique, à la fois ancré dans l’érémitisme et tourné vers une revitalisation de l’idéal bénédictin originel, s’inscrit dans le contexte plus large d’un renouveau religieux du XIIe siècle. À cette époque, de nouvelles formes d’organisation du monde laïc étaient également expérimentées. L’histoire artistique de l’abbaye est marquée par un aspect particulièrement significatif: la décoration des manuscrits. Cette pratique soulève la question de l’existence d’un scriptorium actif au sein du monastère. Cependant, déterminer avec certitude la présence d’un tel atelier demeure complexe, en raison des pertes considérables subies au fil des siècles. La rareté des témoins manuscrits conservés — certains se trouvant dans d’autres bibliothèques — contraste en effet avec l’hypothèse d’une production initialement plus vaste, compromise à la fois par des circonstances accidentelles et par les vicissitudes historiques auxquelles la congrégation a été confrontée. Un corpus de codices enluminés associés à Montevergine a pu être reconstitué grâce à l’étude croisée des manuscrits, des archives et des témoignages indirects. Malgré les incertitudes que présentent certains fragments, le manuscrit connu sous le nom de Statut de l’abbé Donat constitue un exemple incontestable de production verginienne. Ce document se caractérise par l’intégration de représentations humaines et divines au sein de sa composition, ce qui lui confère une solennité remarquable. Il s’agit d’une véritable déclaration d’identité pour la congrégation elle-même.
De L’Architecture cistercienne de Marcel Aubert aux Saint Bernard de Jean Leclercq et Georges Duby et au Rêve cistercien de Léon Pressouyre (1943-1994). Réflexions autour d’un mythe historiographique
Xavier Barral i Altet
On s’accorde à définir l’art cistercien par des constructions qui chercheraient la simplicité architecturale et refuseraient la décoration superflue en accord avec les principes de l’ordre d’ascétisme religieux et de pauvreté. Les résultats auraient donné des architectures propres, vides, simples et fort originales. Le premier art cistercien définirait le passage de l’art roman tardif au premier gothique. Telle est la définition la plus utilisée par le grand public de ce
que l’on a parfois appelé le mythe cistercien.
Mais, au cours de la deuxième moitié du XXe siècle, l’art cistercien a été approché de diverses manières, depuis l’enquête d’archéologie monumentale à la manière du XIXe siècle de Marcel Aubert (1884-1962), jusqu’à l’archéologie pratique de Léon Pressouyre (1935-2009), sans oublier l’approche de l’art à travers la spiritualité de Dom Jean Leclercq (1911-1993). Dans le cas de Georges Duby (1919-1996), au-delà de sa synthèse de pensée, c’est la beauté de l’écriture qui l’emporte. En 1962 parut le volume consacré à l’art cistercien dans la collection La nuit des temps des éditions Zodiaque, dont la partie monumentale fut confiée à Dom Anselme Dimier (1898-1975). Les somptueuses planches en noir et blanc reproduites en héliogravure ont contribué puissamment à ce que Philippe Plagnieux a appelé le vagabondage sacré et le pèlerinage touristique.