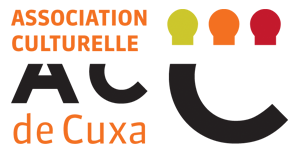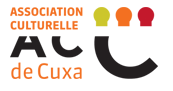Jean-Claude Bonne, École des Hautes Études en Sciences sociales
Conférence d’ouverture : Sanctifier le monde.
I. l’art roman face à la question des rapports entre le sensible et le spirituel dans la création
« L’homme, l’art et la nature » ne sont pas des catégories universelles et univoques qu’on pourrait associer à des réalités évidentes. Quand nous pensons « Nature » —une notion aux sens multiples et aujourd’hui encore changeants— on dira que le Moyen ge pensait d’abord « Création », un monde terrestre, originellement harmonieux et tout sanctifié mais qui, à la suite de la faute des premiers hommes, a été maudit par Dieu. Cette malédiction s’est traduite par une dysharmonie qui s’est établie à l’intérieur de l’homme et dans le monde entre le sensible et le spirituel. Le Christ a essentiellement rétabli la possibilité d’un lien spirituel de l’âme humaine avec Dieu, sans que le message évangélique engage une rédemption notable du reste du monde terrestre. L’Église et particulièrement le monachisme du Haut Moyen ge ont développé une doctrine ascétique du mépris et du détachement du monde considéré comme corrompu. On a cru pouvoir encore associer cette conception à la réforme grégorienne du XIe siècle et considérer l’irréalisme et le schématisme notoires des figures romanes comme l’expression d’un rejet du sensible au profit de vérités purement intelligibles. En réalité, la réforme initiée par Grégoire VII s’est proposé de reprendre le contrôle des communautés religieuses relâchées pour mettre le spirituel à la tête d’une société, elle-même renouvelée, et non pas pour situer le spirituel en dehors de la société. Le corps est nécessaire à l’âme qui le vivifie, comme les biens matériels le sont à l’Église féodale dont l’Esprit-Saint sanctifie les possessions. L’essor considérable que connaît la production des images religieuses au XIe et XIIe siècles traduit, à sa manière, une intensification du besoin de retrouver une articulation positive entre le spirituel et le corporel, par-delà toute tentation de dualisme. Il ne s’agit pas de tenter d’échapper au sensible mais plutôt de trouver à re-sanctifier un monde en proie à des forces invisibles, spirituellement saintes ou diaboliques, mais aussi matériellement bénéfiques ou maléfiques au sein desquelles l’homme vit en très étroite dépendance avec son milieu qui n’est pourtant pas isolable du cosmos. Si l’image romane montre toujours la nécessité de se tourner vers le spirituel, c’est parce que celui-ci vient infuser (le mot est de Hugues de Saint-Victor) du spirituel dans le matériel, ce qu’on appellera une spiritualisation du matériel.
Mais l’époque et l’art romans ne sont pas monolithiques, ils sont traversés par des tensions, tensions dont la définition de la création formulée par le même Hugues de St-Victor est un bon témoin : « tout cet univers, ce monde sensible, est pareil à un livre écrit du doigt de Dieu, c’est-à-dire créé par la puissance divine (virtute divina), et toutes les créatures sont comme des figures […] établies par le jugement de Dieu pour manifester et, pour ainsi dire, signifier d’une certaine manière sa sagesse invisible ». Si Hugues de Saint-Victor reste naturellement attaché, comme l’art roman, aux 4 sens traditionnels de l’Écriture étendus à l’exégèse chrétienne de l’histoire, il déclare, dans le traité dont est extraite cette citation, son admiration de la « nature » végétale et animale, autrement dit du monde au sens littéral, dont la beauté lui paraît un témoignage sensible manifeste, c’est-à-dire direct ou immanent de la sagesse divine. On a souvent souligné l’apparition, sous le nom de « Renaissance du XIIe siècle », d’une nouvelle sensibilité au monde d’ici-bas, un éveil, a-t-on dit, à « la consistance de la nature, à sa cohérence rationnelle, à son autonomie vis-à-vis de la causalité divine » (D. Poirel). Il est vrai que les philosophes physiciens de l’École de Chartres (dont l’un des intervenants parlera) entrent parfaitement dans ce cadre. Mais l’intérêt pour l’image plus naturaliste de la « nature » ne se manifestera que dans certains formes de l’art gothique et surtout Renaissant. Il convient donc d’avancer quelques propositions sur les modes de figuration de l’image romane.
II. De l’image romane
L’image religieuse (sur laquelle on se concentrera) est toujours attachée à un objet-support — Bible, mobilier, objets ou livres liturgiques, chapiteaux, pavement d’église… — auquel elle doit montrer son attachement matériel et symbolique, sans chercher à s’en autonomiser et qu’elle doit « orner » pour célébrer sa sacralité, tout en ornant aussi et du même mouvement ce que, en tant qu’image, elle doit signifier (Bède dit que les images servent à « orner et instruire », je dirai que l’ornementation peut être, elle aussi, une manière d’instruction moins sur leur sens que sur les valeurs de ce qu’elles figurent).
L’ornementation, comme je la comprends, ne se réduit pas à un genre aux motifs distincts confinés dans les bordures des images, elle est une modalité de construction des formes et de distribution des couleurs qui sert tout à la fois à exalter la sacralité du support et à qualifier positivement mais aussi négativement ou d’une façon ambivalente (ce qui fait au moins 3 valences possibles) le sujet de l’image. L’ornement ajoute une plus-value esthétique, graphique, plastique ou chromatique qui doit montrer son artificialité (ou mieux son caractère artificieux pour rester au plus près du sens de ars en latin) dans l’image à laquelle elle peut s’intriquer étroitement afin d’assurer simultanément la célébration visuelle de l’objet-support de l’image et la dé-naturalisation spiritualisante de son sujet. L’ornementalité (Focillon dit « la pensée ornementale ») est une structure symbolique fondamentale de la qualification et de la re-sanctification intensive de l’image médiévale du monde d’ici-bas et d’attestation de la sacralité des objets, des lieux et des personnes en charge de gérer les rapports de l’homme avec le divin.
On éclairera ces propositions, trop synthétiques, par l’analyse du dessin au trait coloré et de la distribution intensive des couleurs d’une scène de l’Annonciation aux bergers (montrant des hommes, des bêtes et du végétal) dans un Sacramentaire roman des environs de 1100.
III. Les différents genres de créatures
Ils nous sont fournis par les images de la Création. Celles qui sont inspirées par les récits de la Genèse débouchent sur la Chute après laquelle le monde se voit transformé.
D’une part, la terre ne fournit plus spontanément aux êtres vivants leur nourriture (intégralement végétale avant la chute), les forêts deviennent un monde hostile et l’homme doit les défricher pour travailler la terre et en tirer les moyens de survivre comme il apparaît dans les représentations des travaux des mois, reliés à l’organisation cyclique du cosmos. Et un type savant d’image montre que l’homme est un microcosme, miroir analogique du macrocosme.
D’autre part, après la Chute, le monde vivant est, lui aussi, transformé. Les animaux déjà distingués avant la Chute se répartissent désormais en 5 catégories : le pecus qui sont les animaux domestiques, soumis à l’homme, les bestiæ ou bêtes sauvages dont certaines sont devenues carnassières et donc agressives (symbole ambivalent des forces positives, négatives ou ambivalentes à l’œuvre dans le monde), les oiseaux qui sont des êtres globalement positifs et médiateurs avec le monde céleste parce qu’ils volent et sont plus proches du ciel, les poissons (représentant du monde aquatique), enfin les êtres rampants (appelés vermines) associables au monde satanique qui s’est infusé dans la Création. Mais celle-ci n’est pas seulement caractérisée par l’opposition du Bien et du Mal en lutte dans l’homme pécheur, elle est aussi marquée par l’opposition entre ce qui est bénéfique (les fruits du travail) et maléfique pour l’existence de l’homme comme les catastrophes, la pénurie, les mauvais sorts (qu’il faut conjurer), la douleur et la mort (avec la crainte du Jugement). C’est toute cette Création déchue qu’il s’agit de resanctifier comme doit le montrer l’image.
IV. Des différents modes d’être des créatures et des animæ (les âmes) qui les animent
Au-delà des genres des êtres vivants et de leur apparaître sensible, se pose la question de leurs modes d’être ou de leur nature invisible, autrement dit des animæ qui les animent, et de la façon dont leur action se traduit dans l’image romane.
On peut considérer avec un bon encyclopédiste et vulgarisateur de la pensée théologique de la première moitié du XIIe siècle, comme Honorius Augustodunensis, qu’on reconnaît traditionnellement quatre modes d’être ici-bas.
- Il y a d’abord la matière qui est faite de la composition à des degrés divers des quatre éléments, le corps de l’homme présentant le meilleur équilibre entre les qualités des quatre. Cette doctrine antique a été transmise par les Pères de l’Église comme Isidore de Séville qui l’a mise en schémas. Ceux-ci ont été repris et amplifiés à l’époque romane et constituent un type d’image abstraite et théorique de la nature de la création, avant les grands diagrammes gothiques.
- Au-dessus de la matière, Honorius dit que l’homme a trois vires animæ (puissances animantes de l’âme) ce que Hugues de Saint-Victor, qu’on associera au propos, appelle la « triplex animæ vis» (la triple puissance de l’âme).
S’il faut s’arrêter sur ce point c’est que l’une des fonctions de ce que j’ai appelé l’ornementalisation romane de l’image est de contribuer à la figuration que je dirai à la fois analogique (d’un point de vue cognitif) et animique (d’un point de vue vitaliste) des puissances de l’âme. La première est nommée par Hugues de Saint-Victor animæ vis in vegetandis (que les philosophes, comme Guillaume de Conches, appelleront bientôt « anima vegetalis »), elle « fournit au corps la vie en sorte qu’une fois né il croisse et qu’en se nourrissant, il subsiste ». Honorius formule la chose ainsi : « la vie est la puissance de l’âme qui vivifie le corps et cela nous l’avons en commun avec les plantes et les arbres ».
Avant de signifier la végétation qui en est la forme exemplaire parce que nue, le mot vegetatio et les mots de la même famille signifient la puissance germinative de la vie, de même que natura est apparenté à nasci qui veut dire naître. Ce point est très important pour comprendre que l’image romane confiera à l’artificialité d’une végétation ornementale le pouvoir d’allégoriser et d’animer la puissance vivifiante sous-jacente de la vie — ce qu’on pourrait appeler la vis animæ vegetalis qui est vita — en même temps que son rapport (analogique et substantiel) avec les forces spirituelles plus profondes, saintes, diaboliques ou ambivalentes qui sont à l’œuvre dans la création et que l’homme doit affronter en lui-même. On illustrera ce thème avec des images romanes, positives, négatives ou ambivalentes de l’homme inscrit (ou pris ?) dans un rinceau végétal (et aux prises avec des animaux).
- Au-dessus de l’âme vivifiante-végétalisante, il y a l’anima sensorielle, celle des cinq sens qui permet de juger du sensible. Hugues, à la différence d’Honorius, accorde aux animaux l’imagination et la mémoire. Honorius se contente de dire « Le sentir est une puissance de l’âme qui confère au corps la sensibilité (Sensus est vis animæ quæ corpus sensificat) » et il ajoute, « nous l’avons en commun avec les bêtes et tous les êtres animés (cum bestiæ et omnibus animantibus) ». Honorius ne dit pas les « animaux » mais il nomme deux catégories les bestiae, c’est-à-dire les bêtes devenues sauvages, et les animantes, mot (animans) de la famille de animal ou animalis, dont aucun ne veut dire « animal » et ne définit, comme nous l’entendons, une catégorie d’êtres différents des hommes, mais « être animé ou vivant ».
- Avant d’en venir aux rapports de l’homme avec les autres êtres vivants, particulièrement les bestiæ, on ajoutera que l’homme possède en outre une âme entièrement ou au moins plus spirituelle que les précédentes que Dieu lui a « insufflé » (mais sans doute avec toutes les autres) à la création et qu’on peut définir globalement comme ratio. Elle comporte différents formes ou degrés dont le plus haut se nomme « l’intellect » qui est elle aussi une vis animæ mais accédant à l’intelligence des réalités incorporelles.
À ces puissances de l’âme ou ces âmes multiples (appelée tantôt anima, tantôt spiritus) aux limites insaisissables et fluctuantes entre le spirituel (réputé incorporel) et la quasi corporéité nécessaire à son activité dans le monde, à ces âmes dans ou entre lesquelles les théologiens multiplient les distinctions (dont nous n’avons pas à connaître ici) correspond dans les images l’extrême perméabilité ou l’osmose entre le spirituel et le matériel, par l’infusion de forces occultes, quasi-magiques dans le visible, qui s’étendent loin dans l’univers.
C’est ce que confirme l’image romane des bestiæ sur laquelle il nous faut revenir, comme plus largement sur l’extension du champ des créatures vivantes autres que l’homme.
On n’abordera pas la question des bestiaires, non plus que des herbiaires puisqu’il sera traité dans d’autres présentations. À la différence des images romanes courantes qui n’ont besoin, sauf exception, que de figurations très génériques des animaux et des plantes, ces ouvrages inventorient un nombre considérable d’espèces dont ils définissent les propriétés médicales ou autres quand ils ne les moralisent pas.
On ne pourra s’étendre sur les hybrides, comme la sirène, le centaure, le griffon ni sur les peuples lointains inconnus ou mal connus aux caractères monstrueux, parce qu’inhabituels, toujours plus ou moins animalisés, qui sont tenus soit pour bien réels, soit pour imaginairement tout à fait possibles dans une Création dont on ne connaît pas les limites. En tout état de cause, ces êtres devaient être susceptibles d’une certaine exégèse (au minimum d’être des témoins ornementaux, au sens qualifiant précis qu’on a dit, de la diversité et de l’altérité des créatures). On n’évoquera que le cas de l’Éthiopien (qui a deux paires d’yeux).
On s’intéressera davantage à quelques images romanes majeures des rapports de force entre les hommes et les bestiæ, bêtes sauvages ou monstrueuses dont les images évoquent les désordres violents, la domination des bêtes sur l’homme (la dévoration) ou inversement l’emprise de l’homme sur les bêtes. Affrontements considérés comme image du combat du Bien contre des forces diaboliques ou ténébreuses du mal dont seul triomphe des hommes exceptionnels et/ou images du combat intérieur contre les tendances basses et les pulsions charnelles de l’homme. Mais la force de ces bestiæ, aussi mauvaise soit elle, peut être captée et mise au service du Verbe en se pliant aux formes de la lettre, ce qui est une manière de sanctifier la force (fortitudo) qui est une vertu capitale dans un monde féodal violent.
Pour relier au plus intime l’animalité, la végétalité et l’humanité, on retiendra des images de végétalisation de parties des animaux bénéfiques ou maléfiques comme leur queue, et surtout l’image omniprésente dans l’art roman d’un masque humain ou animalisé émettant du végétal ou étant traversé par lui. Hybridations qui sont l’image d’une continuitas de la vita indissociablement sensible et spirituelle qu’on dira animique plutôt qu’animiste, car les animæ, créations divines, ne sont pas, pour le monde ecclésiastique du moins, des entités autonomes, même si la croyance superstitieuse à des puissances quasi animistes, agissant au sein de la création, a eu cours dans la culture populaire.
Mais le christianisme roman en se réclamant de ce qu’on pourrait appeler, avec Hugues de Saint-Victor, « l’esprit qui est la force occulte de la nature (hic spiritus, id est, occulta naturæ vis) », sur l’activité divine ou l’autonomie de laquelle les théologiens eux-mêmes commençaient à se disputer, n’ouvrait-il pas le champ à la possibilité ou à la tentation de rapporter l’immensité de l’immaîtrisable dans la création à des entités occultes tels de nouveaux avatars acculturés par la société romane de déités mythologiques de l’Antiquité.